Le travail du sexe
La dernière tentative d’encadrer juridiquement la prostitution au Canada ouvre le débat sur les protections du droit du travail pour les travailleurs du sexe.
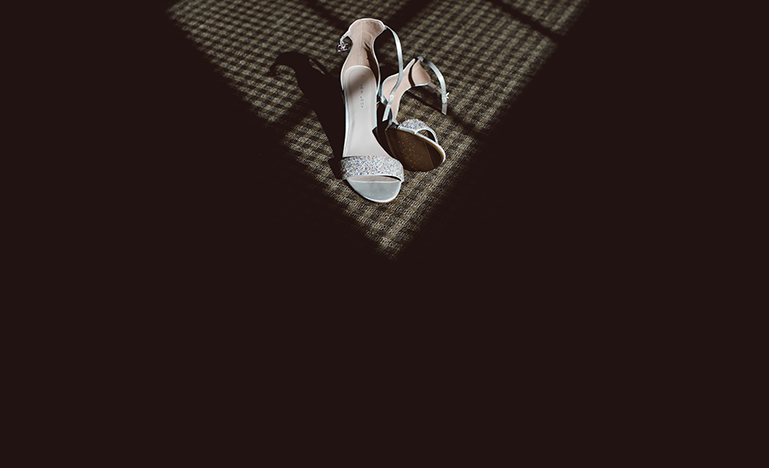
Le projet de loi C-36, les changements proposés par le gouvernement pour encadrer la prostitution au Canada, se rapproche de la rue (au moment d’aller sous presse, le projet de loi en était à l’étape du rapport du comité à la Chambre des communes). Mais une question largement ignorée par le gouvernement dans ses efforts pour remplacer les règles sur la prostitution, invalidées par la Cour suprême l’an dernier dans l’arrêt Bedford, est la manière dont l’industrie du travail du sexe serait réglementée dans une perspective d’emploi.
Depuis Bedford, le gros du débat entourant l’adoption d’un nouveau régime juridique pour le travail du sexe s’est concentré sur la question de savoir si le Canada devrait adopter le modèle nordique — qui fait de la prostitution un crime en ciblant seulement ceux qui achètent des services sexuels — ou s’inspirer des Pays-Bas et la décriminaliser. Le Parlement a choisi la première option.
Mais des avocats anticipent que C-36 est bon pour la poubelle constitutionnelle puisqu’il érige des barrières injustes autour des travailleurs du sexe qui cherchent à se protéger dans leur emploi. Katrina Pacey, directrice juridique chez Pivot à Vancouver, est du nombre. « C-36 aura l’effet de continuer à rendre les conditions de travail et la vie des travailleurs du sexe plus dangereuse », affirme Me Pacey. « Le spectre et la réalité de la criminalisation signifient qu’ils continueront à avoir un manque d’accès aux services et au soutien dont ils ont besoin — que ce soient des services juridiques, ou un accès complet et égal à des services sociaux. »
Ni le gouvernement, ni les tribunaux n’ont reconnu la prostitution comme un « travail ». Plutôt, la volonté d’Ottawa d’abolir le commerce du sexe — en vertu des nouvelles règles, il est clair que la prostitution serait considérée comme un tort social et non pas, comme certains le souhaitaient, comme du travail légitime — n’a pas laissé beaucoup de place pour discuter des détails d’une protection juridique des travailleurs qui, grâce à Bedford, verront leur travail être décriminalisé dès décembre, avec ou sans nouveau régime.
Mais ce cadre juridique entourant l’industrie est une question sur laquelle Ottawa devra se pencher tôt ou tard. Pour l’instant, le projet de loi C-36 rend illégal l’achat de services sexuels ou la tenue d’une maison de débauche, mais il sera légal de solliciter des clients ou gérer une entreprise à une seule personne.
Cela pourrait compliquer la vie aux travailleurs du sexe qui voudraient répondre aux critères pour être considérés comme des employés — sans parler du fait que leurs employeurs seraient considérés comme des criminels. Malgré tout, certains de ces travailleurs pourraient réussir à se placer sous la protection du droit du travail.
Qui est le patron?
« Le plus gros obstacle pour que les lois sur le travail s’appliquent est que vous avez besoin d’un employeur », note Gwendoline Allison, une associée au Foy Allison Law Group à Vancouver, et auteure d’un rapport qui offre un point de vue sur la manière dont le droit du travail pourrait s’appliquer, selon la manière dont le droit criminel considère la prostitution.
Selon Me Allison, qui est intervenue dans Bedford pour le groupe Asian Women Coalition Ending Prostitution, la nature même de la prostitution transcende le cadre actuel du droit du travail. Un travailleur du sexe qui œuvre dans la rue, par exemple, est susceptible d’avoir un proxénète qui collecte ses gains avant de lui en retourner une portion. Cette relation, que C-36 qualifie d’exploitation, sera criminalisée en vertu du nouveau régime. Mais les codes provinciaux du travail requièrent également qu’un employeur rémunère ses employés et justifie toute déduction. Donc un proxénète pourrait-il être tenu responsable de verser un salaire ou de payer des heures supplémentaires, dans l’éventualité où un recours serait intenté contre lui?
Il reste aussi à déterminer si les tribunaux traiteront les travailleurs du sexe qui œuvrent dans des bordels comme entrepreneurs indépendants ou comme des employés. Comme dans des bars de danseuses nues ou des salons de massage, les travailleurs du sexe peuvent garder tout, une partie ou aucun des gains qu’ils récoltent. Ils peuvent aussi avoir à dédommager le propriétaire des lieux ou contribuer à certains de ses frais d’exploitation.
La distinction n’est pas que théorique. Les employés se voient accorder certaines protections en vertu de lois sur les normes du travail : on leur garantit un salaire minimum et des vacances, ils peuvent former des syndicats et ils ont accès à des tribunaux des droits de la personne.
La décision la plus pertinente à cet égard a été rendue en 2001 dans Sagaz Industries Canada. La Cour suprême a établi des critères pour déterminer ce qui constitue un entrepreneur indépendant ou un employé. Parmi ces facteurs, on trouve le niveau d’autonomie du travailleur, l’utilisation de son équipement personnel au travail, le choix des employés, l’existence de risques financiers assumés par le travailleur et le plus important, le degré de contrôle que l’employeur exerce sur lui.
Appliqué aux travailleurs du sexe, ce test nécessiterait que l’on détermine si le gérant est responsable de l’achat de produits prophylactiques, de vêtements, et de la location de chambres, par exemple. Le gérant emploie-t-il des employés de soutien? Quelles opportunités économiques l’entreprise donne-t-elle au travailleur du sexe?
Me Pacey croit que les travailleurs du sexe passent le test. « Lorsque j’examine et dissèque les conditions de travail, et les circonstances de l’emploi d’une personne, je les caractériserais comme des employés », dit-elle.
« Mais ils n’ont pas de recours pour faire valoir ce droit ou pour dire à leur employeur : ”en fait, je suis un employé et je voudrais aller aux normes du travail pour le prouver”. Alors ils se font qualifier d’entrepreneurs indépendants, ce qui, je crois, n’est pas le cas dans plusieurs de ces lieux de travail. »
La grande question, estime Me Allison, est le niveau de liberté des travailleurs dans une maison de débauche ou une agence. S’il peut prouver que l’équipe de gestion a dans les faits eu un niveau de gestion et de contrôle directs sur leur travail, les travailleurs pourraient être considérés comme des employés.
Il est important de se rappeler qu’en vertu du projet de loi C-36, les travailleurs du sexe peuvent toujours se faire arrêter s’ils font de la sollicitation dans certains endroits ou s’ils violent l’interdiction d’exploiter une entreprise commerciale. Donc une considération cruciale pour établir si des travailleurs du sexe pourraient revendiquer des droits en vertu des lois sur le travail est de savoir si l’employeur — le propriétaire d’une maison de débauche par exemple — est criminalisé.
Les nouvelles règles légalisent les relations qui ne sont pas basées sur de l’exploitation entre les travailleurs du sexe et ceux qui soutirent un bénéfice de leur travail — les chauffeurs, gardiens de sécurité ou propriétaires d’immeubles. Il faut par contre qu’ils facturent la valeur marchande pour leurs services, et qu’ils offrent les mêmes services au public en général.
Mais les nouvelles règles criminalisent aussi les propriétaires d’entreprises qui offrent des services sexuels. Il reste à voir où la ligne est tracée entre le propriétaire d’un hôtel qui compte plusieurs travailleurs du sexe parmi ses pensionnaires, et une personne qui exploite une entreprise commerciale qui offre des services sexuels.
Théoriquement, si ce propriétaire d’hôtel pouvait opérer légalement et qu’il était aussi impliqué dans la gestion des travailleurs du sexe, il pourrait être considéré comme un employeur. Une cour devrait décider s’il s’agit d’une relation basée sur de l’exploitation. Si la réponse est non, le propriétaire de cet hôtel reçoit-il une juste contrepartie pour ses services? Si la réponse est oui, alors, ce serait légal.
Cette distinction en apparence arbitraire pourrait rendre les nouvelles règles vulnérables aux recours judiciaires, comme les anciennes dispositions sur les maisons de débauche ont été invalidées dans Bedford. Et ce serait l’occasion d’ajouter certaines protections supplémentaires pour les travailleurs du sexe, en faisant valoir qu’un propriétaire d’entreprise répond au test de l’employeur dans Sagaz.
Une autre question demeure quant à savoir si les salons de massages érotiques et les agences d’escorte seraient criminalisés en vertu de C-36. Le projet de loi ne définit pas clairement les « services sexuels » de manière à englober la zone grise dans laquelle ces entreprises ont toujours évolué. Le gouvernement a certainement suggéré que c’était son intention, mais de fermer des établissements qui ont pu opérer pendant toutes ces années pourrait s’avérer difficile.
C’est aussi dans ce type d’entreprises que les travailleurs du sexe seraient en mesure d’établir clairement l’existence d’une relation employeur-employé avec les dirigeants.
De plus, dans certaines circonstances, les travailleurs du sexe pourraient agir comme les employeurs — par exemple, s’ils se regroupent en coopérative pour défrayer les coûts et partager l’embauche d’employés. Il n’est pas clair si ce type de partenariats serait légal considérant l’interdiction pour une entreprise commerciale de soutirer un bénéfice de telles activités. Mais si ce partenariat passait le test de la légalité, il devrait fournir un lieu de travail équitable pour ses employés : réceptionniste, gardes du corps, chauffeurs, etc.
Quel niveau d’autonomie?
Compliquant aussi les choses pour déterminer le statut d’emploi d’un travailleur du sexe est le fait que les contrats, sans surprise, sont rares dans l’industrie.
Évidemment, les contrats qui violent le droit criminel ne sont pas valides. Mais si un jour l’activité est légalisée, ces contrats deviendraient essentiels pour permettre aux travailleurs du sexe de réclamer les bénéfices de la protection offerte par le droit du travail. Les travailleurs du sexe pourraient signer un contrat avec leur employeur décrivant les services qu’ils offrent. La question devient ensuite une question de consentement : quel niveau d’autonomie un travailleur du sexe serait-il prêt à céder, et un employeur pourrait-il sanctionner ou congédier un employé qui n’a pas fourni les services établis dans son contrat?
« Çela peut arriver dans n’importe quel milieu de travail », affirme Kerry Porth, la présidente de Pivot Legal Society, à Vancouver, et une ancienne travailleuse du sexe. « Un employeur dit: “tu fais mal ton travail, car tu refuses de faire ceci.” Et là tu peux en appeler de sa décision et donner tes raisons à l’appui. »
Il est impossible de céder un consentement, note Me Pacey, et les travailleurs du sexe auraient toujours le droit de refuser d’offrir un service. Un employeur mécontent qui déchirerait un contrat pourrait s’attirer un recours en congédiement injustifié.
En même temps, si les travailleurs ont le droit de refuser d’offrir certains services et de choisir leur client, est-ce que cela implique qu’ils sont autonomes au sein de l’entreprise? Selon Me Allison, on pourrait alléguer qu’ils agissent comme entrepreneur indépendant.
Un lieu de travail comme les autres?
Que ce soit dans une maison de débauche ou sur la rue, plusieurs lieux de travail qui sont considérés comme étant normaux dans l’industrie du sexe seraient jugés inacceptables dans d’autres milieux. Cela rend l’application de règles sur la santé et la sécurité au travail difficile, c’est le moins que l’on puisse dire.
Il serait peu probable qu’une maison de débauche ou une agence souhaite contribuer aux régimes d’indemnisation des accidents de travail, mais cela ne signifie pas que leur responsabilité n’est pas en jeu. Un client ou un travailleur pourrait faire valoir qu’ils se sont fait transmettre une infection transmise sexuellement (ITS). La violence est aussi un risque bien réel.
Selon Me Allison, si les maisons de débauche étaient légalisées, un ensemble distinct de critères, meilleures pratiques et exigences devraient être adoptés.
Une préoccupation réelle est le dépistage obligatoire des ITS, ce qui est requis dans certaines régions de l’Australie. Des groupes de défense du travail du sexe estiment que cela pourrait constituer une violation des droits de la personne, et la Cour suprême pourrait être d’accord avec eux : dans un dossier de 2013, elle a tranché qu’un employeur ne pouvait forcer l’employé d’une usine de pâtes et papiers à se faire tester pour l’usage de drogues.
Le dépistage obligatoire des travailleurs du sexe présente aussi un défi pour les autorités, selon Me Pacey. Nécessiterait-elle l’enregistrement des travailleurs auprès d’une instance quelconque? Une tentative de créer un registre des travailleurs du sexe pourrait ne pas avoir les conséquences souhaitées. « Ça pourrait donner l’impression que ce n’est pas du soutien », met en garde l’avocate. « Ça pourrait donner l’impression que c’est plutôt une enquête. »


